L'Islam d'Afrique, au-delà des catégories simplistes
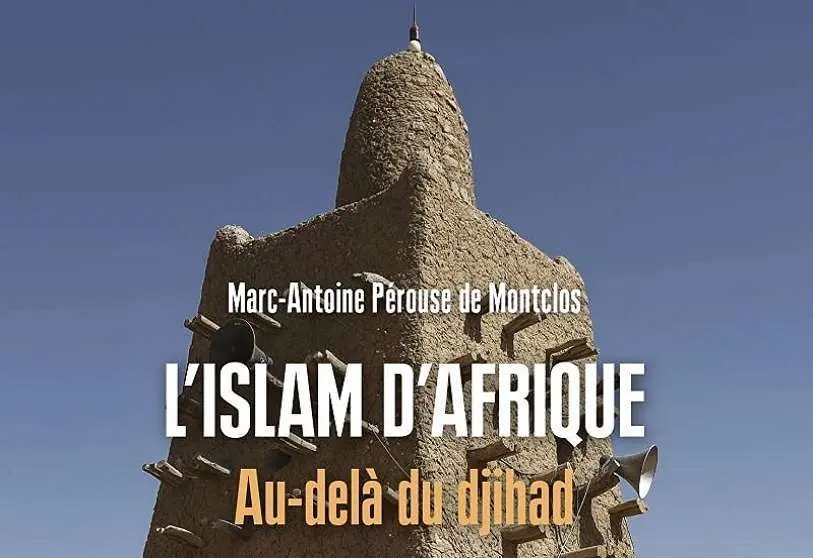
L'Afrique subsaharienne n'apparaît pas beaucoup sur nos écrans, et lorsqu'elle le fait, c'est généralement pour rendre compte du dernier outrage perpétré par des groupes terroristes tels qu'Al-Shabab en Somalie et dans d'autres régions d'Afrique de l'Est, Boko Haram dans le nord du Nigeria et dans les pays voisins, l'un des divers groupes djihadistes opérant au Sahel, ou ISIS-Mozambique dans le nord du Nigeria. Le continent a été intégré dans la lutte internationale contre le terrorisme, et des troupes d'une douzaine de pays non africains y sont actuellement stationnées. Ce livre intéressant remet en question nombre de nos hypothèses sur l'islam en Afrique et les conflits dans lesquels la religion musulmane joue un rôle. Comme l'indique son sous-titre, "au-delà du djihad", "L'islam d'Afrique" cherche à présenter la question dans toute sa complexité afin de réfuter certains des principaux arguments utilisés pour expliquer ces conflits et justifier les interventions armées étrangères.
Notre auteur, le chercheur africaniste Marc-Antoine Pérouse de Montclos, commence par souligner l'importance de l'islam africain. D'ici 2050, il y aura plus de musulmans en Afrique subsaharienne que dans l'ensemble du monde arabe, car le taux de natalité dans la région reste élevé - surtout chez les musulmans, qui ont tendance à vivre dans les zones les moins développées de l'intérieur - alors que l'espérance de vie s'allonge. En outre, le soufisme est particulièrement important sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest, qui est devenue le centre de gravité de confréries d'origine arabe telles que la Tiyaniyya et la Qadiriyya. Plus douteux sont les arguments avec lesquels il tente de nous convaincre de l'influence intellectuelle de l'islam africain. Il souligne, par exemple, le rôle de certains clercs africains dans des institutions saoudiennes telles que Dar al-Hadith et l'Université islamique de Médine, qui semblent des cas anecdotiques.
Selon Pérouse de Montclos, le discours actuel sur l'islam africain repose sur des simplifications réconfortantes. Les politiciens et les intellectuels africains, ainsi que les spécialistes occidentaux, ont tendance à attribuer l'émergence des mouvements djihadistes à l'émergence du salafisme d'origine saoudienne, qui s'oppose au soufisme traditionnel des sociétés africaines. Replaçant le phénomène dans son contexte historique, l'auteur montre que cette opposition entre un islam africain soufi, syncrétique et modéré et un islam arabe littéraliste, sectaire et agressif n'est pas nouvelle, mais remonte à l'époque coloniale, c'est-à-dire plusieurs décennies avant l'émergence des pétromonarchies exportatrices du salafisme. Ainsi, la préoccupation française pour les connexions arabes des confréries soufies au Sahel remonte au XIXe siècle. Plusieurs puissances européennes possédant des colonies en Afrique ont suivi l'exemple des Pays-Bas qui, en 1889, ont ouvert un bureau d'aide sociale à La Mecque pour surveiller "leurs" musulmans malais pendant le pèlerinage. En 1912, les Britanniques ont créé un institut d'études islamiques à Khartoum pour empêcher les imams africains d'aller étudier à l'université Al-Azhar du Caire, où ils pourraient être en contact avec des idées "subversives".

D'autre part, l'opposition simpliste d'un islam africain "modéré" et d'un islam arabe "violent" cache des vérités gênantes, comme le fait que les jihads du passé, dirigés par des soufis, n'avaient rien à envier, en termes de brutalité, à ceux dont nous sommes témoins aujourd'hui. Le Qadirid Usman dan Fodio (1754-1817) et le Tiyanid Omar Tall (1794-1864) ont tous deux établi des proto-États - respectivement le califat de Sokoto (dans les actuels Nigeria, Niger, Cameroun et Burkina Faso) et l'empire Tuculor (dans les actuels Mali, Guinée et Sénégal) - par le pillage et la subjugation. Usman dan Fodio est célébré comme un héros national et l'une des universités de la ville de Sokoto porte son nom, bien que le califat qu'il a fondé ait connu l'un des taux d'esclavage les plus élevés jamais enregistrés (entre un tiers et la moitié de la population). Dans un autre exemple, nous trouvons un précédent à la destruction de mausolées et de manuscrits à Tombouctou en 2012-13 dans l'incendie de livres de sciences religieuses par le mahdi soudanais autoproclamé, Mohamed Ahmad (1844-1885), bien que dans son cas, le motif était qu'il n'avait lu que le Coran et voulait cacher son ignorance.
Notre auteur problématise également la caractérisation du soufisme comme intrinsèquement tolérant face à un salafisme intolérant. Il nous rappelle qu'au Sahel, de nombreux soufis marabouts continuent de soutenir l'excision et le mariage avec des filles prépubères, tandis que le calife mouride sénégalais, Sidy Mokhtar Mbacké, a appelé à des manifestations contre Charlie Hebdo, une semaine à peine après les attentats qui ont tué 12 des collaborateurs du magazine satirique. Pour leur part, la grande majorité des salafistes condamnent la violence djihadiste. De plus, certaines de leurs critiques du soufisme semblent raisonnables, comme le fétichisme et l'exploitation des étudiants soufis des écoles coraniques contraints de mendier. Les salafistes sont souvent relativement bien éduqués et travaillent dans le secteur moderne de l'économie et, d'une certaine manière, ils expriment le désir de modernisation des sociétés musulmanes. Ainsi, l'affrontement entre soufis et salafis pourrait presque être considéré comme un conflit générationnel entre traditionalistes et réformateurs.
Il convient de noter que les musulmans d'Afrique ne se reconnaissent généralement pas dans les catégories imposées de l'extérieur qui ont été créées pour classer l'islam au Moyen-Orient. Les soi-disant salafistes - et même les djihadistes comme Al-Shabab, Boko Haram ou Jama'at Nusrat al-Islam - ne pratiquent pas le rite hanbali du salafisme arabe, ou le combinent avec le malikisme typique des régions dans lesquelles ils opèrent. Malgré cela, les dirigeants politiques et religieux de la région n'hésitent pas à utiliser ces catégories à leur avantage. Ainsi, après les attentats du 11 septembre 2001, les soufis tanzaniens ont accusé leurs adversaires salafistes de terrorisme pour saper leurs tentatives de bouleverser les hiérarchies traditionnelles. Et en 2015, Mohammed VI a créé un institut de formation pour les oulémas africains, prétendument pour promouvoir l'islam malikite et soufi "modéré" au Maroc, mais aussi dans l'intention d'obtenir un soutien politique à l'occupation du Sahara occidental, comme le dénoncent les autorités algériennes.

Une autre constante dans le discours habituel sur l'Islam est sa politisation. Pérouse de Montclos conteste qu'il s'agisse d'un phénomène récent, affirmant que l'Islam a eu une forte dimension politique depuis sa création en vertu de la position de Mahomet en tant que prophète et fondateur d'un État. Il souligne également qu'elle a été utilisée politiquement par les soufis bien avant l'avènement du salafisme : les deux groupes ont utilisé le takfir (excommunication) et le djihad dans le but supposé de ramener les musulmans sur le "droit chemin". Hier comme aujourd'hui, l'islam a servi d'instrument de légitimation, comme dans le cas de la proclamation d'un califat, ou de contestation, comme dans la pratique de la rébellion contre des souverains déclarés "infidèles". En réalité, la religion est utilisée pour articuler les griefs causés par la marginalisation de certains groupes ou par la concurrence pour les ressources et le territoire, quand elle ne sert pas à cacher des motivations sordides comme la cupidité.
Selon l'auteur, ceux qui parlent de la politisation de l'Islam ne font que comparer la situation actuelle avec le passé immédiat. En effet, les idéologies dominantes dans les pays devenus indépendants après la Seconde Guerre mondiale étaient le nationalisme et le socialisme du tiers monde, tandis que l'urbanisation croissante et la diffusion de l'éducation ont contribué à la sécularisation de leurs sociétés. Cependant, l'échec du projet nationaliste et la fin de la guerre froide, qui s'est accompagnée de l'effondrement des régimes dictatoriaux, ont permis la création de multiples partis de tendances idéologiques et identitaires différentes. Dans le même temps, les crises de la dette et les programmes d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale qui ont suivi ont contraint les gouvernements à réduire les services fournis à leurs citoyens. Cet espace était occupé par toutes sortes d'associations, y compris des associations musulmanes.
Pérouse de Montclos ne voit aucune raison de s'alarmer de la visibilité croissante de l'Islam dans les sociétés africaines. Comme elle l'explique, il n'existe pas de mouvement panislamique ; les partis et associations musulmans présentent les mêmes divisions que celles qui affligent les communautés qu'ils représentent, lesquelles sont de nature religieuse, sociale et ethnique. La diffusion du voile et de vêtements similaires a permis aux femmes d'être plus présentes dans l'espace public, car elles se sentent moins affectées par les menaces qui pèsent sur leur réputation ou par la simple impossibilité d'acheter des vêtements et des cosmétiques. Les djihadistes ont été incapables d'établir un contre-projet de société viable, et leurs déprédations ont discrédité les idées qu'ils défendent. Et bien qu'ils fassent l'objet d'une attention disproportionnée, les affrontements entre musulmans et chrétiens restent l'exception et, lorsqu'ils se produisent, ils ne sont pas motivés par la religion mais par des questions telles que l'accès aux ressources. Ainsi, les bergers fulanis, qui sont généralement musulmans, n'attaquent pas les agriculteurs majoritairement chrétiens du nord du Nigeria en raison de leur religion, mais parce que les sécheresses constantes exacerbées par le changement climatique les ont chassés de leurs pâturages ancestraux. D'autre part, les musulmans qui peuvent se le permettre envoient souvent leurs enfants dans des écoles chrétiennes en raison de leur bonne réputation académique.

Bien sûr, tout bon argument peut être poussé trop loin. Pérouse de Montclos lui-même ne peut éviter de faire allusion au boom pétrolier, qui a permis aux États du Golfe d'exporter un islam qui non seulement rejette le soufisme, mais promeut des attitudes intolérantes envers les adeptes d'autres religions. En effet, il reconnaît que les salafistes sont souvent hostiles aux chrétiens, qu'ils considèrent comme des transmetteurs de la culture occidentale, ce qui accroît sans aucun doute les tensions dans des sociétés déjà fragiles et fragmentées. En revanche, malgré sa connaissance incontestable de l'Afrique et de l'Islam, l'auteur présente quelques lacunes. Par exemple, il traduit le terme arabe tuba par "conversion" (il s'agit de tawba, "repentance" ou "pénitence"). Il affirme que le terme Nassara, parfois utilisé pour désigner les chrétiens, fait référence à la conquête et à la victoire (il vient de al-Nâsira, "Nazareth"). Et il prétend que le grand réformateur de l'Islam Muhammad 'Abduh rejetait les influences chrétiennes et occidentales, alors qu'en fait il était un grand admirateur de la civilisation occidentale et disait à son propos : "Je suis allé en Occident et j'ai vu l'Islam, mais pas de musulmans ; je suis retourné en Orient et j'ai vu des musulmans, mais pas d'Islam".
Néanmoins, "L'islam en Afrique" mérite notre attention. Il s'agit d'un ouvrage très didactique, qui ajoute à ses plus de 400 pages plusieurs cartes, un appendice contenant des informations sur les confréries soufies en Afrique et un glossaire. Elle est également nécessaire parce qu'elle nous oblige à reconsidérer nos stéréotypes sur l'Afrique et parce qu'elle contient des leçons applicables au-delà du continent. Il critique à juste titre le soufisme, qui est souvent entouré d'une aura de romantisme plus qu'orientaliste. Et il souligne avec certitude que l'islam n'est pas un problème en soi, mais qu'il est utilisé comme un instrument de mobilisation dans des conflits qui n'ont rien ou presque à voir avec la religion. C'est pourquoi les politiques actuelles qui favorisent les interventions armées et ignorent les causes sous-jacentes de la violence - comme l'intervention antiterroriste menée par la France au Sahel - sont non seulement inefficaces, mais peuvent exacerber ces conflits.








