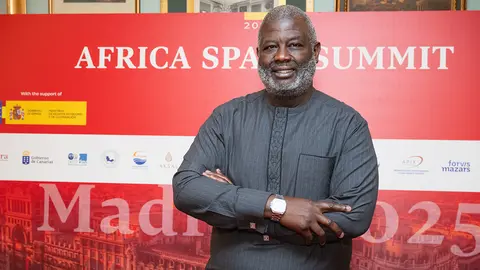L’Europe, encore utile à l’Afrique ?

Au lieu de se demander si elle a encore un rôle à jouer en Afrique, elle ferait mieux de réfléchir à la nature de ce rôle, à sa légitimité, et surtout à sa capacité à s’adapter à un continent qui change à grande vitesse.
L’Afrique d’aujourd’hui n’est plus le terrain d’influence qu’elle a longtemps été pour les chancelleries occidentales. Elle devient un champ d’arbitrage, où les partenariats se construisent selon des logiques de résultats et d’avenir partagé.
Dans cette nouvelle donne, l’Europe semble chercher son souffle. Il ne s’agit pas de nier les liens historiques, économiques, culturels – souvent douloureux – qui unissent les deux blocs. Mais de reconnaître que ces liens ne suffisent plus à faire récit.
Le langage diplomatique ne passe plus. Les visites de courtoisie non plus. L’Afrique regarde désormais vers l’Asie, les puissances du Golfe, la Turquie, parfois même vers l’Amérique latine. Elle diversifie ses alliances, elle choisit ses interlocuteurs. Et elle le fait sans complexe.
Et les mécanismes de soft power montre leur limite : le Global Gateway, doté de 300 milliards d’euros pour contrer l’influence de la Chine et des États-Unis dans les pays du Sud, prévoit de flécher 150 milliards vers l’Afrique d’ici à 2027. On peut se demander qu’est ce qui explique cette perte d’influence ?

Une relation qui doit faire sa mue
Pendant trop longtemps, l’Europe a traité l’Afrique comme un espace d’aide, de gestion migratoire ou d’ajustement structurel. Rarement comme un partenaire stratégique égal. Les mécanismes de coopération sont restés enfermés dans des logiques d’« accompagnement » paternaliste, avec un langage technocratique qui ne prend pas en compte la montée des aspirations africaines. Résultat : déconnexion.
Alors que les capitales africaines cherchent des solutions rapides, efficaces, et structurantes, Bruxelles s’attarde encore sur des modèles dépassés, souvent dictés par des priorités internes. Cette inertie est d’autant plus problématique que d’autres acteurs, eux, avancent.
La Chine, les Émirats, l’Inde investissent, construisent, écoutent, forment. C’est là que l’Europe est attendue. Par exemple sur le plan économique cette réalité est parlante : Le déficit annuel en investissements dans les infrastructures africaines dépasse 150 milliards de dollars.
Le paradoxe, c’est que l’Europe, grâce à son ancrage historique et culturel, a toutes les cartes en main. Elle reste le premier bailleur d’aides publiques au développement (plus de 40 % de l’aide mondiale) et, grâce à un stock de plus de 200 milliards d’euros, le premier investisseur direct étranger sur le continent.
Le Vieux continent ne peut plus se contenter de « vendre » sa proximité historique ou ses valeurs. Il doit « acheter » sa place dans la nouvelle architecture économique africaine. En sommes il serait faux de dire que l’Europe est condamnée à l’effacement.
Elle reste, dans certains pays, un investisseur majeur, un bailleur d’influence. Elle dispose d’un capital diplomatique, institutionnel, et éducatif non négligeable. Mais ce capital s’érode, lentement mais sûrement, si rien ne change dans la méthode.
Pour retrouver sa place, l’Europe devra faire sa mue. Sortir de la verticalité. Renoncer à vouloir piloter les dynamiques africaines. Accepter de négocier, de partager...