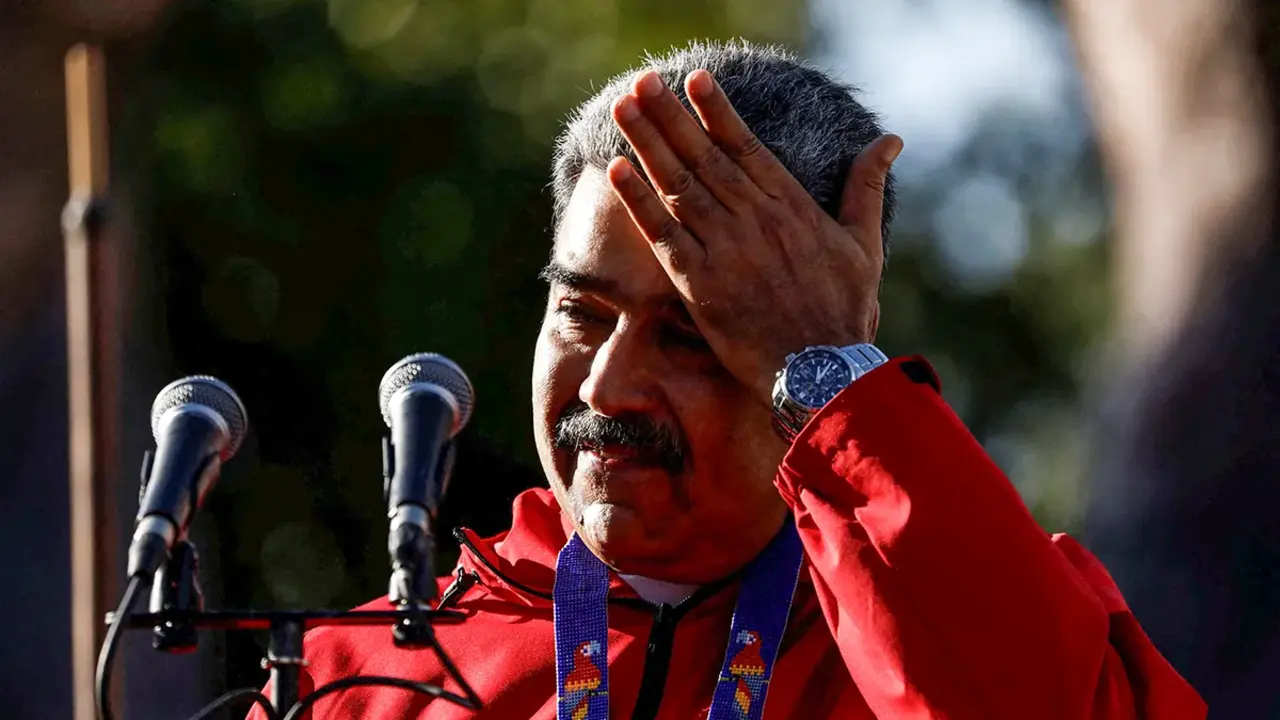L'Algérie : un acteur clé pour le Sahel

Cet acteur n'est autre que l'Algérie, et il est important de connaître la situation d'un pays que nous pouvons considérer comme un voisin, car il n'est séparé de nos côtes que par quelques kilomètres, qui lutte avec le Maroc pour occuper le rôle de puissance régionale et qui, tout comme le royaume alaouite, est le rempart contre le radicalisme islamique.
Au cours des dernières décennies, l'intérêt de l'Algérie pour les questions de sécurité au Sahel s'est considérablement accru, car la région est devenue un refuge pour les terroristes. Et si quelqu'un a de l'expérience dans la lutte contre ce fléau dans la région, c'est bien l'État algérien.
Les États du Sahel, qui partagent de longues frontières avec l'Algérie, ont connu une augmentation disproportionnée de l'insécurité en raison de divers facteurs tels que l'instabilité de leurs systèmes politiques, la situation économique difficile, le manque de développement dans plusieurs régions, la prolifération des armes, l'activité de groupes criminels organisés et le trafic illégal de personnes et de toutes sortes de drogues. De même, l'instabilité politique a été à l'origine de plusieurs crises qui ont abouti à des coups d'État successifs qui ont affecté plusieurs pays du territoire, dont le Mali.
L'État algérien lui-même a connu, après la démission du président Bouteflika, une période de troubles qui nous a fait retenir notre souffle face à la possibilité d'un début de confrontation civile qui contribuerait à la déstabilisation totale du pays.

Ce type de situation politique fragile est évidemment le reflet de la théorie du domino. En d'autres termes, l'effondrement d'un État peut provoquer un effet domino susceptible de déstabiliser toute la région. L'Algérie est une république constitutionnelle dans laquelle le président est le chef de l'État et le Premier ministre le chef du gouvernement. Cependant, de facto, l'Algérie est gouvernée par sa puissante armée et un groupe restreint d'hommes d'affaires et de politiciens connu sous le nom de « Le Pouvoir ». C'est pourquoi l'Algérie a souvent été qualifiée de « démocratie contrôlée ».
La situation politique actuelle en Algérie semble relativement stable. Malgré les fréquentes émeutes provoquées par le Mouvement Hirak, il est difficile qu'elles débouchent sur une guerre civile comme cela s'est produit dans le pays voisin, la Libye. Le peuple algérien a beaucoup souffert, le souvenir de la guerre civile (1991-2002) est encore frais et les citoyens algériens sont, en général, prudents lorsqu'il s'agit de provoquer une répétition d'un tel bain de sang, même si le fait est que les jeunes sont moins enclins à accepter le statu quo actuel, dans lequel tout le pouvoir politique est entre les mains de l'armée et de ceux qui sont liés au Front de libération nationale, le parti nationaliste qui gouverne l'Algérie depuis son indépendance en 1962.
C'est la raison sous-jacente de l'augmentation des tensions qui ont abouti à l'émergence du mouvement Hirak, qui a réussi à forcer la démission du président Bouteflika en avril 2019 après des mois de manifestations populaires peu violentes. Cependant, aucun changement politique réel n'a eu lieu depuis lors, et le régime a profité de la pandémie de COVID-19 comme d'une occasion en or pour mettre fin aux manifestations du Hirak.
Depuis son arrivée au pouvoir, le président Tebboune a remplacé plusieurs généraux influents, en particulier ceux liés à l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, décédé en décembre 2019, qui avait construit avec beaucoup de patience et de soin un vaste réseau d'influence au sein du gouvernement algérien et avait alors réussi à faire de l'ancien président Bouteflika, dont la santé était vraiment précaire, devint sa marionnette. Tebboune a démantelé une partie de l'influence militaire au sein du gouvernement, mais l'ancien système reste en vigueur dans la pratique. Même les élections législatives de juin 2021 n'ont pas apporté de changement à cet égard.

Malgré cela, le Mouvement Hirak a perdu de son importance. Tout d'abord, parce que le régime a pris des mesures énergiques contre ses dirigeants, ainsi que contre le journalisme indépendant et d'autres groupes d'opposition, en emprisonnant des centaines de personnes et en dissolvant les organisations de la société civile qui ont joué un rôle important dans les manifestations. Cependant, deuxièmement, et c'est probablement plus important, la division au sein du mouvement, y compris une faction qui, bien que n'étant pas la plus forte, était la plus dangereuse, et qui tentait de le transformer en une rébellion islamiste, a fait que la majorité silencieuse s'est déconnectée du mouvement et s'est retirée des manifestations de rue, ce qui a entraîné une perte de vitesse pour l'ensemble du mouvement de protestation.
Lors des élections de septembre de l'année dernière, Abdelmadjid Tebboune a été réélu avec un peu plus de quatre-vingt-quatre pour cent des voix. Les élections n'ont pas été exemptes de controverses et d'accusations d'irrégularités de la part de l'opposition.
Si l'on s'attarde sur la situation économique, la croissance de l'Algérie en 2023 a été plus qu'acceptable, alors que l'inflation commençait à ralentir. La croissance du PIB a approché les 4,1 %, soutenue principalement par la croissance du secteur des hydrocarbures, qui a bénéficié de la situation créée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la nécessité pour l'Europe de compenser l'approvisionnement en gaz russe interrompu par les sanctions (bien que cette interruption n'ait pas été totale). Cette augmentation de la demande de gaz algérien a compensé les réductions successives des quotas de production de pétrole brut.
L'inflation s'est maintenue à 9,3 % tout au long de 2023, avant de ralentir pour atteindre 5 % en glissement annuel au premier trimestre 2024, dans un contexte de baisse soutenue des prix des produits frais, de la vigueur du dinar et de la baisse des prix à l'importation.

La baisse des coûts des hydrocarbures a réduit le surplus de la balance courante en 2023, tandis que le déficit budgétaire et le ratio dette publique/PIB ont augmenté. La baisse des prix à l'exportation des hydrocarbures et des engrais et l'intensification des volumes d'importation se sont traduites par une réduction rapide du surplus du compte courant. Cependant, et bien que les recettes budgétaires provenant des hydrocarbures soient restées stables, le déficit budgétaire global a augmenté pour atteindre 5,2 % du PIB en raison de la forte augmentation de la masse salariale et des dépenses d'investissement. Le déficit a été principalement financé en dehors du secteur bancaire, avec une diminution de l'émission d'obligations, une augmentation de l'épargne pétrolière à 8,2 % du PIB et une légère augmentation de la dette publique à 49,2 % du PIB.
En conséquence, la croissance a ralenti tout au long de 2024. Dans un contexte d'augmentation des importations et des dépenses publiques, la baisse des recettes pétrolières a de nouveau exercé une pression sur les balances extérieure et budgétaire. La variabilité des prix des hydrocarbures reste le principal risque pour les équilibres macroéconomiques, et les besoins de financement prévus soulignent l'importance d'un rééquilibrage budgétaire progressif.
Avec un revenu par habitant de onze mille deux cents dollars, les Algériens bénéficient de meilleures conditions économiques que la plupart des pays africains. Cependant, le chômage des jeunes reste le principal problème. Les prix élevés de l'énergie provoqués par l'invasion russe en Ukraine ont été une excellente occasion d'atténuer les dommages économiques causés par la crise de la COVID-19, car le gaz naturel est un produit d'exportation clé. Cependant, la majeure partie des revenus provenant des hydrocarbures ne constitue qu'un soulagement économique temporaire, sans laisser de marge de manœuvre pour réinvestir en vue d'une diversification structurelle à long terme de l'économie.

Dans un pays où les tensions ethniques ou tribales sont pratiquement inexistantes, le facteur économique, , ainsi que la perception d'un manque de liberté ou d'une vie dans ce que l'on pourrait appeler une démocratie surveillée, avec le rôle incontestablement prépondérant des forces armées et de l'élite entrepreneuriale déjà mentionné, deviennent le principal risque de déstabilisation, et les groupes les plus radicaux sont attentifs, comme on a pu le voir en 2019, à exploiter cette faille dès que l'occasion se présente.
Un autre facteur à prendre en compte est la position de l'Algérie sur la scène internationale, qui a toujours été un pays proche de l'Union soviétique dans le passé et de la Russie aujourd'hui. Et Moscou ne perd pas de vue que l'Algérie est son atout le plus puissant dans toute la région, où sa présence est déjà évidente au Mali et au Burkina Faso. Cette position augmente le risque que la Russie exerce son influence pour provoquer une déstabilisation régionale aux conséquences funestes pour l'Europe, tout en nous privant, du moins en partie, du gaz algérien si nécessaire. Et dans le contexte actuel, où l'on commence à parler de négociations en Ukraine, il est plus que probable que la Russie prenne sa revanche en multipliant les actions dans la zone grise, et dans le Sahel, la pièce maîtresse est l'Algérie. Nous devons être très attentifs à tout ce qui s'y passe.
D'autre part, si nous utilisons les conceptions du rôle national, nous pouvons mieux expliquer la stratégie algérienne au Sahel, en utilisant également d'autres approches habituelles dans la littérature, comme l'approche identitaire.

La manœuvre actuelle de l'Algérie au Sahel est marquée par un activisme fort et un engagement clair pour protéger ses intérêts nationaux à l'étranger et étendre son influence régionale et sa puissance douce dans la région du Sahel. Par conséquent, pour mieux comprendre le rôle croissant de l'Algérie dans la région instable du Sahel, il est utile d'examiner comment les changements au niveau régional, associés aux principales préoccupations en matière de sécurité, peuvent affecter la dynamique intrarégionale. La littérature récente a attribué l'implication de l'Algérie dans son voisinage à sa position géographique centrale, en tant que voisin des trois pays qui composent le Sahel africain, où l'Algérie a toujours été un poids lourd régional.