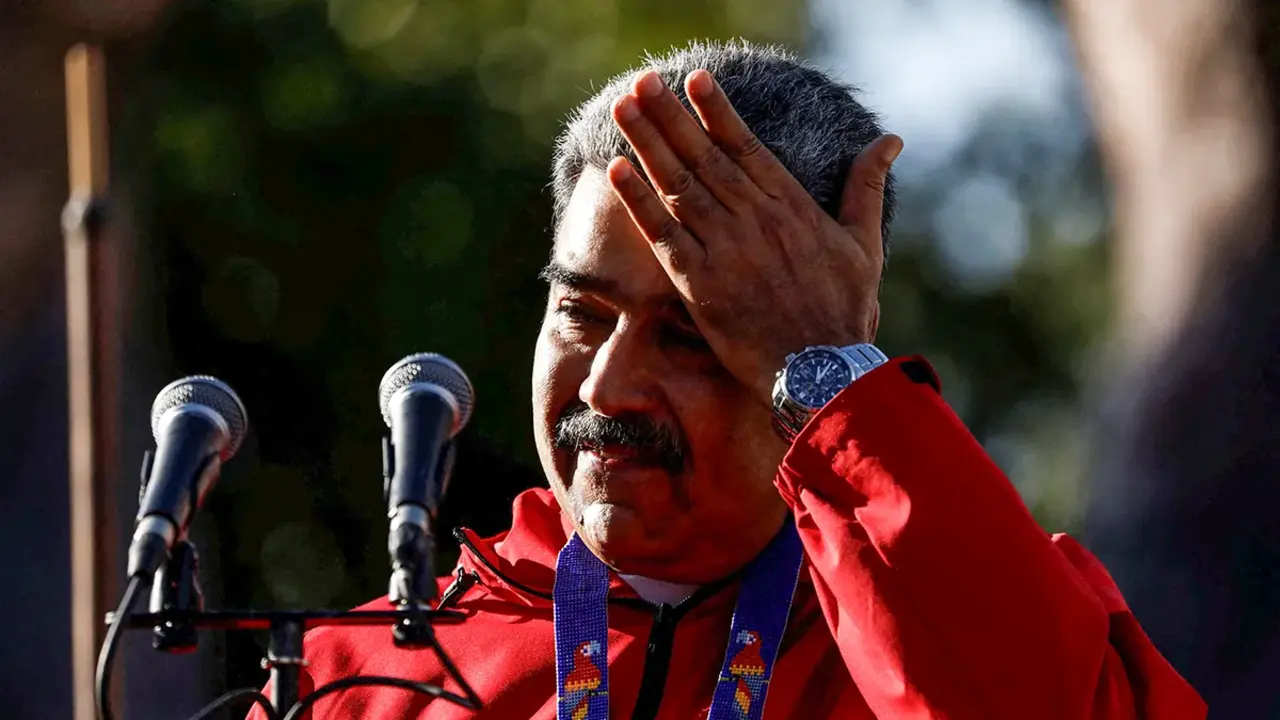L'Arctique. Le grand atout russe (II)

Depuis le célèbre discours de Gorbatchev sur l'Arctique à Mourmansk en 1987, la position internationale adoptée sur la question a pris un certain caractère exceptionnel. La communauté internationale a supposé, ou plutôt espéré, que l'isolement géographique et climatique de la région permettrait également de l'isoler des tensions générées dans d'autres régions de la planète et de la protéger pour qu'elle ne devienne pas une zone de confrontation entre les grandes puissances.
Mais au vu des événements de ces dernières années et de l'attitude de la Russie dans le concert international, il n'est pas surprenant qu'il y ait ceux qui, dans une approche réaliste, sont prêts à changer ce paradigme. En 2015, l'Institut finlandais des affaires internationales a publié un document intitulé « Réflexions critiques sur le caractère unique de l'Arctique », dans lequel il est dit que ce qui se passe en Ukraine ne s'arrêtera pas là, et que des événements similaires dans d'autres parties du monde finiront par se reproduire à proximité de la région arctique.
La faisabilité ou non des propositions visant à préserver la sécurité dans l'Arctique est étroitement liée au fait que la région est considérée comme une véritable « exception ». Jusqu'à présent, et malgré ce qui s'est passé en Ukraine, on peut considérer qu'il en est ainsi, et la propension de tous les pays ayant des intérêts dans la région à coopérer est plus grande qu'ailleurs.

Bien que les contacts avec la Russie dans la région sur les questions sécuritaires et militaires aient été considérablement réduits, la déclaration d'Ilulisat de 2008 peut toujours être considérée comme en vigueur, et tant le forum des garde-côtes que l'accord sur les SAR et le contrôle des rejets continuent de servir de cadre à la mise en œuvre des efforts de coopération.
Il est incontestable que les effets du changement climatique, ainsi que les progrès technologiques en matière de brise-glaces à propulsion nucléaire, ouvrent un vide d'espoir pour la navigabilité complète de l'océan Arctique. Ceci, ajouté aux énormes réserves d'énergie et autres ressources qu'elle détient dans ses profondeurs, ajoute une grande valeur commerciale potentielle à l'importance stratégique préexistante que possédait déjà la côte nord de la Russie.
L'importance stratégique du théâtre nordique pendant les années de guerre froide résidait dans le fait qu'il était le bastion de la flotte du Nord. Aujourd'hui, bien que diminuée par les changements qui ont suivi la chute du mur et à une époque où la dissuasion nucléaire a été reléguée au second plan, cette importance demeure, tandis que le flanc arctique qui fait face au Pacifique gagne en importance avec l'émergence d'une Chine de plus en plus importante et développée qui revendique sa place dans le concert international.
Tout cela signifie que depuis 2007, la Russie a entamé une campagne énergique démontrant clairement son intention de redoubler d'efforts pour satisfaire ses revendications dans l'Arctique, en même temps qu'elle a mené des négociations avec d'autres acteurs dans ce domaine de grande importance comme la Norvège, avec laquelle elle a signé un traité en 2010.

Si nous voulons maintenir efficacement la sécurité dans une région, la première prémisse est d'avoir des attentes fiables d'un changement dans l'attitude pacifique des différents acteurs. Et en ce qui concerne la région arctique, il faut accepter que, au moins jusqu'à présent, les conditions pour maintenir une « communauté de sécurité régionale » ont été mises en place d'une manière raisonnablement acceptable. La sécurité commune réside essentiellement dans la certitude des différents membres de la communauté qu'aucun des acteurs ne déclenchera un conflit militaire pour résoudre d'éventuels différends ou désaccords de quelque nature que ce soit. Et en ce qui concerne l'Arctique, les cinq pays de la région ont confirmé cette façon de procéder dans la déclaration d'Ilulisat de 2008, en déclarant qu'ils ont confiance dans un vaste cadre juridique international qui s'applique à l'océan Arctique pour résoudre toute réclamation, tout litige ou tout intérêt particulier de manière satisfaisante pour tous.
Le deuxième élément qui caractérise une communauté de sécurité comme celle à laquelle nous avons affaire est l'absence de course aux armements dans la région. Ou, en d'autres termes, le refus des Etats concernés de s'engager dans une compétition pour augmenter leurs capacités militaires, soit dans la zone elle-même, soit dans des capacités développées spécifiquement pour l'intervention dans la zone (lire, par exemple, dans ce cas, pour développer des unités spécialisées équipées pour combattre sur un terrain avec des conditions hivernales extrêmes).
Ainsi, afin de renforcer les attentes de paix et d'atténuer la préparation d'opérations de guerre de toutes sortes, les pays de la zone doivent prendre certaines mesures clés telles que leurs déploiements militaires ayant un caractère simplement défensif et démontrable et toujours liés à la sécurité publique (un exemple peut être le Canada, dont les UAV drones opérant dans la zone ne sont pas aussi bien armés que sa garde côtière). Une autre mesure est l'utilisation partagée des moyens de sauvetage dans la zone ou l'utilisation de protocoles qui rassemblent les moyens de plusieurs des pays concernés. Redondance dans la transparence des opérations et des exercices militaires dans la région en organisant régulièrement des réunions des responsables de la défense, ainsi qu'en étant explicite dans la déclaration de non-intention de signifier toute menace à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du reste des nations. En outre, dans le cas de l'OTAN, elle a toujours maintenu la région arctique hors de ses zones d'opérations, comme une mesure redondante ou supplémentaire.
Toute mesure qui empêche une escalade ou une course militaire dans la région et qui soutient les attentes d'un « statu quo » fondé sur la paix et la compréhension sera utile pour renforcer l'Arctique en tant que communauté sûre, ce qui en fait certainement une exception dans le contexte international actuel, mais peut en même temps être une pièce du puzzle à partir duquel on peut étendre une architecture de sécurité mondiale.
Il s'agit sans aucun doute d'une situation idéale, qui est loin de la réalité dictée par les événements.

Les raisons pour lesquelles la région arctique revêt une importance stratégique pour le Kremlin sont diverses. Certains ont déjà été décrits dans le premier article de cette série. Mais nous allons maintenant les examiner de manière un peu plus détaillée. Tout d'abord, la région abrite d'importants centres de population. Arkhangelsk est la plus grande ville de l'Arctique avec une population d'environ 350 000 habitants, suivie de la plus connue, Mourmansk, qui compte 300 000 habitants. Si nous les comparons avec la ville la plus peuplée de la région appartenant aux États-Unis, qui est le NUUK avec 17 000 habitants, nous voyons que la différence est plus que significative. Et ces chiffres sont déjà un indicateur important.
Mais ce qui est significatif en soi et qui change les règles du jeu dans la région, c'est que sous la direction de Vladimir Poutine, la région arctique russe a été réaffirmée et mise en avant comme une question patriotique et nationaliste de haut niveau. L'économie russe est fortement dépendante de son industrie pétrolière et gazière, et comme déjà mentionné, ces ressources sont abondantes dans l'Arctique, y compris dans la région de Yamal où la Russie possède une énorme usine de gaz naturel liquéfié. C'est pourquoi la Russie est très sensible à tout mouvement ou action qui pourrait affecter la sécurité de son infrastructure énergétique.
La route dite de la mer du Nord, également mentionnée ci-dessus, qui, pour être plus explicite, longe la côte russe de la mer de Kara au détroit de Béring, devient progressivement plus praticable, bien qu'elle soit encore loin de devenir une route principale, car la navigation dans cette zone est extrêmement difficile : selon les données de 2017, seuls 27 navires l'ont traversée cette année-là. Mais malgré cela, c'est un point important en raison du volume et des marchandises particulières qui y transitent. Cette même année, un record a été établi, enregistrant un volume total de transit de 9,74 millions de tonnes, principalement du gaz, du pétrole, du blé et du charbon. Ces chiffres font de cette route une artère économique majeure pour le pays, avec un énorme potentiel de croissance, c'est pourquoi la Russie va essayer de la garder sous son contrôle et de la protéger à tout prix.
Il y a un autre fait qui ne peut être négligé. La Russie est le seul pays côtier de la région arctique qui n'appartient pas à l'OTAN, et considère l'Arctique comme une zone clé pour la protection de son intégrité territoriale. D'un point de vue militaire stratégique, il existe un paradoxe intéressant. Les conditions météorologiques et la glace qui recouvre la mer la majeure partie de l'année rendent cette partie de la côte russe inaccessible pendant des mois, alors que le changement climatique et le recul progressif des limites de la glace modifient progressivement cette situation. La flotte de la mer du Nord est basée sur la péninsule de Kola, près de Mourmansk, et cette structure militaire possède les deux tiers de la flotte russe de sous-marins nucléaires. La conclusion est que l'Arctique est à la fois la masse de glace et d'eau qui protège les moyens de dissuasion stratégiques de la Russie et la porte d'entrée qui permettrait à une partie considérable de ses forces navales d'atteindre l'Atlantique Nord.
Au cours des dix dernières années, la Russie a progressivement et considérablement accru ses capacités militaires dans l'Arctique, en ouvrant de nouvelles bases aériennes et en rénovant celles qui existaient déjà, en créant un commandement spécifique pour la région et deux nouvelles unités de brigade spécialement équipées et entraînées pour opérer dans cette zone. Dans le même temps, il est prévu d'augmenter la flotte de brise-glaces, dont beaucoup sont à propulsion nucléaire, même s'ils sont déjà les plus grands du monde.

La nouvelle base militaire construite à Aleksandra est considérée comme le plus grand bâtiment de tout le cercle arctique. En 2015, le ministre russe de la défense de l'époque a fait valoir que l'Arctique nécessitait une présence militaire constante et, conformément à ces déclarations, la « Stratégie maritime 2015 » a mentionné la région arctique comme deuxième priorité après l'Atlantique, mais avant le Pacifique, ce qui est plus qu'éloquent. Poursuivant dans la même veine, le même document publié en 2017 a mis en évidence la perception de graves menaces militaires pesant sur les intérêts russes dans l'Arctique.
Il est évident que la Russie présente tous ces mouvements et le développement de ses capacités militaires dans l'Arctique avec un caractère purement défensif, ce qui est vrai, mais dans une certaine mesure. Et depuis les événements de Crimée, avec l'annexion de la région et la guerre par procuration qui a suivi dans l'est de l'Ukraine, les doutes sur les intentions réelles de la Russie n'ont fait que s'accroître. La plupart de ces capacités peuvent être utilisées à des fins défensives ou offensives. Entre autres actions, les systèmes de radar déployés sont en cours de modernisation et d'actualisation, des systèmes de missiles sol-air et antinavires sont en cours de déploiement, et certaines unités de l'armée de l'air équipées de MIG-31 et de SU-34 ont déjà été transférées sur la base construite à Aleksandra. Ces mouvements ne sont pas passés inaperçus pour l'OTAN, qui a déjà attiré l'attention sur la capacité du déploiement à refuser l'accès et à prendre le contrôle de plusieurs zones de la région.
S'il y a un pays qui est vraiment préoccupé par cette question, c'est bien la Norvège, en particulier en ce qui concerne la capacité de la Russie à créer une zone interdite qui couvrirait une partie de son territoire avant même que l'OTAN puisse agir pour aider son partenaire. Tout cela a été clairement exposé lors de l'exercice Zapad 17 de la Russie, où elle a démontré une grande partie de ces capacités.
Les tensions avec la Russie en ce qui concerne l'Arctique se concentrent davantage du côté européen que du côté nord-américain. Malgré le fait que les revendications présentées par la Russie devant la Commission pour la définition des limites du plateau continental (CLCS) peuvent entrer en collision avec celles présentées par le Canada, bien que dans ce cas la coopération ait prévalu sur la confrontation et que les scientifiques canadiens et russes aient échangé des informations pendant qu'ils développaient leurs études respectives pour présenter ces revendications.
L'histoire des revendications russes à la CLCS est longue. En 2001, la Russie a déposé une demande formelle sur une zone de 1,2 million de kilomètres carrés, s'étendant des dorsales sous-marines de Lomonosov et Mendeleev au pôle Nord. La Commission a rejeté cette demande sans demander d'autres informations. La réponse russe a été énergique : elle a envoyé une expédition scientifique comprenant un brise-glace nucléaire et deux mini-sous-marins dans la région. Bien sûr, la société a été convenablement médiatisée et suivie par les médias, en particulier au moment où la mission a planté un drapeau russe (en titane) au fond de l'océan au-dessus de la chaîne de montagnes Lomonosov, non sans avoir d'abord recueilli des échantillons qui auraient prouvé que la chaîne de montagnes fait partie de la plaque continentale eurasienne. Lors de cette étape de « confrontation », Artur Chilingarov, à la tête de l'expédition, et vice-président de la Douma, a déclaré : « L'Arctique est à nous, et nous avons l'obligation de prouver notre présence ». Cette déclaration a montré une ligne claire à l'encontre de l'esprit de coopération internationale dans ce domaine, tout en s'avérant totalement inappropriée pour une expédition de nature scientifique.
En 2015, au plus fort de la crise de Crimée, la Russie a de nouveau soumis une demande révisée sur le même territoire. Toutefois, le Danemark, la Norvège, les États-Unis et le Canada ont également des revendications sur la même zone, en tout ou en partie. Les ressources que l'Arctique détient sont essentielles à moyen terme pour soutenir l'économie mondiale, et leur contrôle déterminera l'hégémonie ou le rôle de ceux qui l'exercent. Mais toutes les revendications n'ont pas eu le même résultat. En 2014, la CLCS a résolu sa revendication sur le plateau continental de la mer d'Okhotsk de manière positive pour la Russie. Cela nous montre seulement le jeu juridique et d'intérêt compliqué autour de ce qui est considéré comme la plus grande réserve de ressources naturelles de la planète.

Néanmoins, l'attitude de collaboration demeure pour l'instant, du moins lorsque le niveau purement politique est abandonné. Preuve en est les différents accords internationaux ou bilatéraux conclus depuis 2014, dont l'accord sur le renforcement de la coopération scientifique internationale dans l'Arctique et la proposition russo-américaine (approuvée par l'Organisation maritime internationale) de créer six routes, chacune à deux directions, pour permettre une navigation plus sûre dans le détroit de Béring.
Ces accords montrent comment l'Arctique peut encore servir de catalyseur pour que les deux puissances agissent de manière plus pragmatique et unissent leurs forces sur des questions d'intérêt mutuel. Et malgré ce qui a été dit, dans le contexte actuel, c'est la Russie qui est la plus intéressée à maintenir ce ton de coopération. Si l'on veut s'intéresser à un contexte plus global, la Russie a besoin de la coopération des autres nations arctiques. Son industrie énergétique a besoin d'un environnement de sécurité et de confiance pour continuer à attirer des investisseurs comme la Chine, par exemple, bien plus encore dans un scénario où le nombre possible de ces derniers a été réduit à la suite de sanctions.
Comme on l'a vu dans la première partie de cette exposition, la Russie continue à évoluer entre deux positions plus que complémentaires. On part du principe que la meilleure façon d'atteindre ses objectifs dans l'Arctique est de coopérer et de négocier avec les pays concernés au sein des organismes internationaux créés à cet effet, mais en même temps, on développe les capacités nécessaires pour que, d'une part, elles servent de moyen de dissuasion et de pression et, d'autre part, si nécessaire, elles puissent être utilisées pour revendiquer ou prendre par d'autres moyens ce qu'ils considèrent comme leur possession légitime. Et l'exemple de la Crimée est plus qu'éclairant à cet égard.

L'intérêt croissant du public russe pour l'Arctique a entraîné des changements importants dans les autres nations concernées. Tout d'abord, elle a servi à rapprocher ces nations. La Suède et la Finlande, deux pays non membres de l'OTAN, ont signé un accord de « nation hôte » avec l'Alliance en 2016, la rapprochant plus que jamais du pacte atlantique. Et dans cette ligne, en 2018, un accord tripartite a été signé avec les États-Unis où ils ont réaffirmé leur intention de coopérer dans divers domaines, y compris les exercices militaires conjoints. D'autre part, la Norvège a augmenté le nombre de troupes du corps des Marines américains qui, par rotation, restent sur son territoire. C'est une façon de contourner son accord avec la Russie de ne pas accueillir en permanence des troupes étrangères, à moins qu'il n'y ait une menace réelle.
L'OTAN accorde une attention croissante au problème de l'Arctique, mais c'est un terrain marécageux et tout est mis en œuvre pour essayer d'éviter que ce qui commence à être une situation quelque peu tendue ne devienne encore plus compliqué. D'autant plus que seuls cinq des 29 pays membres de l'Alliance sont des nations arctiques. Cela peut sembler trivial, mais quiconque connaît les tenants et aboutissants du processus décisionnel de l'OTAN et la réticence à envisager d'invoquer l'article 5 en connaîtra les implications. La crise de Crimée et son éventuelle extension aux pays baltes ont montré un flanc très faible que la Russie pourrait bien exploiter à tout moment.
L'Alliance est extrêmement préoccupée par la capacité de la Russie à refuser cet accès ou à interférer avec les lignes de navigation ou même les lignes de communication sur les fonds marins. Par conséquent, la création du nouveau Commandement de l'Atlantique Nord pour protéger les lignes de communication transatlantiques ainsi que la réactivation de la 2ème flotte américaine qui avait été dissoute en 2011 soulignent l'importance que l'OTAN attache à la politique et aux mouvements de la Russie dans la région.
Panel Discussion at the Halifax International Security Forum 2009, ‘Arctic Security: New Great Game?’
Lance M. Bacon, ‘Ice breaker’, Armed Forces Journal, March 2010
George A. Backus and James H. Strickland, Climate-Derived Tensions in Arctic Security, SANDIA Report, SAND2008-6342, Sandia, NM, September 2008
National Security Strategy, Osnovy, 2008; ‘Strategiya natsionalnoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii do 2020 goda’, May 12, 2009
Øystein Jensen and Svein Vigeland Rottem, ‘The politics of security and international law in Norway’s Arctic waters’, Polar Record, Vol. 46, 2009
Roger Howard, ‘The Arctic Gold Rush: The New Race for Tomorrow’s Natural Resources’, London, UK
Strategic Studies Institute Monograph, ‘Russia in the Arctic’, July 2011
Ernie Regehr, ‘Militarization and Arctic Security’, July 23-27, 2017