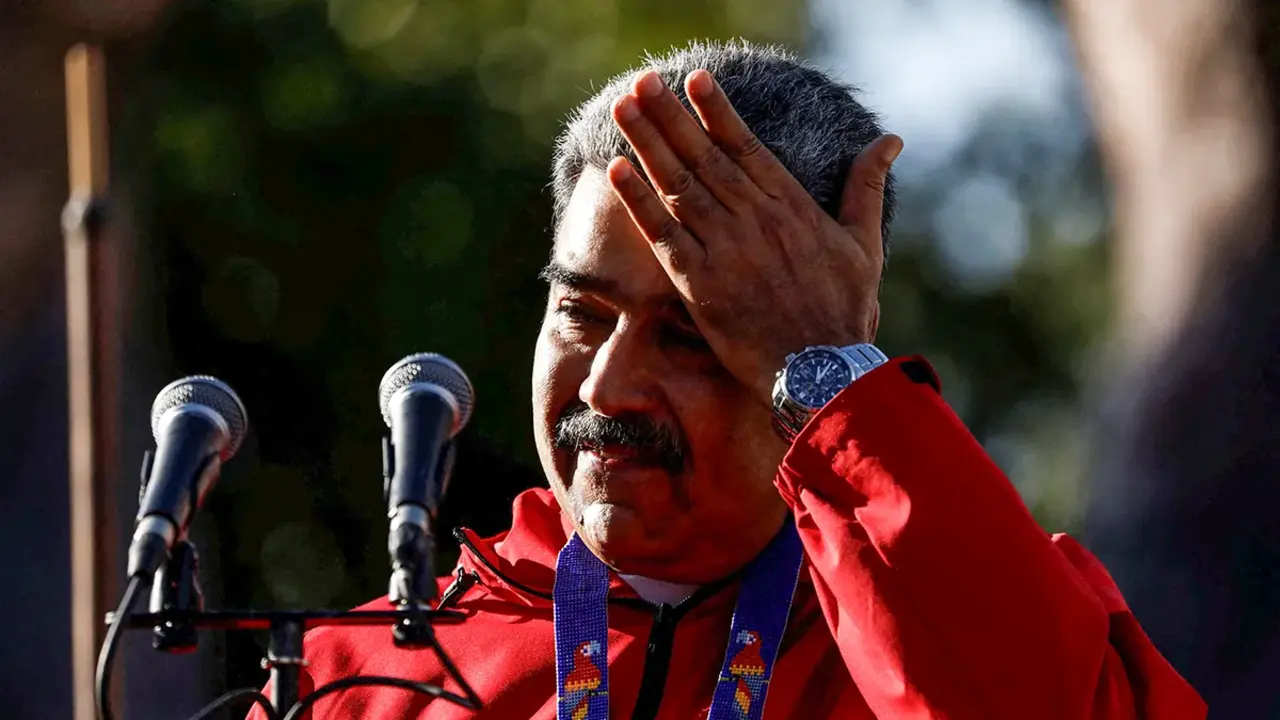Pourquoi le Maroc est-il dans la ligne de mire de Daech au Sahel ?

- Les ambitions terroristes au Sahel : Une menace croissante pour le Maroc
- Le Maroc un rempart pour l’Europe et un acteur clé de la coopération internationale
Le Maroc, situé au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et du monde arabe, occupe une position géostratégique déterminante qui en fait un pilier de la stabilité régionale, tout en le rendant vulnérable aux ambitions expansionnistes de groupes terroristes de la zone sahélo-saharienne. De ce fait, l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), dirigé par Abou Al Barra Sahraoui, ainsi que certaines factions dissidentes du GSIM, de Boko Haram et d'Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), considèrent le Maroc comme un obstacle majeur à leur expansion.
Pour saisir pleinement les origines du chaos qui sévit au Sahel, il est essentiel d’en retracer l’histoire. L’essor du jihadisme dans cette région puise ses racines dans l’évolution du Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), né en Algérie dans les années 1990 à la suite d’une rupture avec le Groupe Islamique Armé (GIA). Cette scission marque un tournant stratégique, le GSPC rejetant les exactions aveugles du GIA au profit d’une expansion plus structurée, cherchant à asseoir son influence au-delà des frontières algériennes. Adoptant une approche plus calculée, le GSPC s’est détourné des violences aveugles pour privilégier une expansion méthodique à l’échelle régionale.
Sous l’impulsion de figures emblématiques telles qu'Abderrazak El Para, de son vrai nom Amari Saifi - aujourd’hui assigné à résidence en Algérie -, l’organisation a su tisser des alliances stratégiques avec des figures influentes du jihad sahélien, notamment Iyad Ag Ghali. Ces connexions ont permis d’ancrer durablement le GSPC dans la mouvance terroriste transnationale, consolidant ainsi un réseau aux ramifications étendues à travers le Sahel.
Cette dynamique a facilité son implantation dans le Sahel et son rapprochement avec d’autres factions locales. En 2007, l’organisation a prêté allégeance à Al-Qaïda et est devenue AQMI, renforçant ainsi son influence sur un territoire élargi. Toutefois, la pression militaire en Algérie et la réorganisation des groupes jihadistes ont favorisé l’émergence de nouvelles structures mieux adaptées au contexte sahélien. C’est dans ce cadre que le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) a vu le jour, fédérant plusieurs factions sous la direction d’Iyad Ag Ghali.
Cette évolution traduit l’adaptation du jihadisme à l’environnement sahélien, exploitant la faiblesse des États et les tensions communautaires pour étendre son emprise sur la région. Cependant, les mutations au sein des groupes jihadistes sahéliens, initialement liés à Al-Qaïda, ont été profondément influencées par l’émergence de Daesh au Levant (Irak/Syrie). Des factions comme Ansar Eddine, Al-Mourabitoune et le MUJAO (Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest) ont progressivement évolué, marquant une rupture idéologique et stratégique. En 2015, une scission au sein d’Al-Mourabitoune - lui-même issu d’une dissociation d’Al-Qaïda au Maghreb islamique - a conduit à la création de l’État islamique au Grand Sahara, lequel a prêté allégeance à l’État islamique au Levant (EI).

Principalement implanté au Mali et actif le long de la frontière Mali-Niger, l’EIGS étend ses opérations jusqu’au Burkina Faso. Son action la plus marquante reste l’embuscade du 4 octobre 2017 contre une patrouille conjointe américano-nigérienne près de Tongo Tongo (Niger), causant la mort de huit soldats (quatre Américains et quatre Nigériens). Cet événement a exposé la dangerosité opérationnelle du groupe et ses capacités à frapper des cibles internationales, renforçant son statut de menace majeure pour la sécurité régionale et occidentale.
Par ailleurs, bien que la coalition internationale ait infligé de lourds revers à Daech en Syrie et en Irak, le groupe a su se réorganiser et se délocaliser vers des zones favorables à son expansion, notamment en Afrique subsaharienne. Selon le Global Terrorism Index 2023, Daech serait responsable de plus de 25 % des décès liés au terrorisme sur le continent, causant ainsi la mort de milliers de personnes, dont plus de 6 800 dans le Sahel en 2023, un chiffre auquel Daech et ses affiliés comme l’EIGS contribuent de manière significative. Par ailleurs, l’impact économique du terrorisme en Afrique est dévastateur : l’ONU estime des pertes totales de 119 milliards de dollars entre 2007 et 2016, tandis que les dépenses de sécurité annuelles s’élèvent à près de 84 milliards de dollars et les déplacements de population génèrent environ 312,7 milliards de dollars de pertes économiques.
C’est un secret pour personne, cette menace dépasse le cadre idéologique et s’inscrit dans un jeu géopolitique où le Royaume joue un rôle central dans la lutte contre le terrorisme. Dans un Maghreb marqué par des ambitions géopolitiques et des tensions diplomatiques, la montée des groupes terroristes s'explique par une conjonction de facteurs structurels. La fragilité des États sahéliens, incapable de consolider une gouvernance sécuritaire efficace, laisse place à des interstices que les réseaux extrémistes n’hésitent pas à exploiter.

Par ailleurs, la porosité des frontières facilite les échanges illicites (drogues, armes et trafique humain) et la circulation transfrontalière de combattants, tandis que l’ingérence d’acteurs étrangers, motivés par leurs propres intérêts stratégiques, accentue l’instabilité régionale.
Par ailleurs, le différend persistant entre le Maroc et l'Algérie, exacerbant la rivalité régionale par le soutien constant de cette dernière au mouvement séparatiste du Polisario, vient compliquer davantage le paysage géostratégique. Cette combinaison crée un environnement propice à l'expansion de menaces sécuritaires, nécessitant une réponse coordonnée pour rétablir la stabilité dans la région. En raison de sa proximité et de son engagement sécuritaire, le Maroc est perçu comme un rempart entravant leur progression.
De cette manière, le Maroc, pleinement conscient des enjeux sécuritaires contemporains, a su élaborer une doctrine de défense robuste articulée autour du renforcement de sa sécurité nationale et de l’optimisation de ses alliances stratégiques. Grâce à une approche proactive et holistique, le Royaume s’est imposé comme un acteur clé de la stabilité régionale, s’appuyant sur une architecture sécuritaire évolutive intégrant des capacités de surveillance avancées, une coordination inter-agences efficace et un dispositif de lutte contre les menaces hybrides. La modernisation de ses forces de sécurité, couplée à l’intégration de technologies de pointe, une architecture de renseignement avancé et la cybersurveillance, a permis au Maroc d’anticiper et de neutraliser les risques émergents. Par ailleurs, la consolidation de ses partenariats internationaux, notamment avec les États-Unis, l’Union européenne et les pays de l’Afrique, renforce sa posture en tant que pourvoyeur de sécurité.
Le Maroc renforce son positionnement en tant que pivot stratégique dans la lutte contre le terrorisme en déployant un renseignement opérationnel performant et en consolidant les capacités des forces sahéliennes à travers des programmes de formation spécialisés dans le cadre du Bureau Onusien de lutte contre le terrorisme à Rabat. Son engagement actif dans les initiatives multilatérales, notamment le Groupe Focus Africa, lui permet de jouer un rôle clé dans la neutralisation des réseaux jihadistes et la maîtrise des menaces transfrontalières.

Les ambitions terroristes au Sahel : Une menace croissante pour le Maroc
Cette approche intégrée fait du Maroc un bastion de résilience et un modèle d’adaptabilité face aux défis sécuritaires en constante évolution. Partenaire stratégique des États-Unis et de l’Europe, le Royaume contribue à la protection du flanc sud de l’Alliance Atlantique et au contrôle des flux migratoires stratégiques vers l’Europe. Sa puissance en matière de renseignement repose sur une architecture sécuritaire sophistiquée et la synergie entre plusieurs services sécuritaires de premier plan. Cette coordination inter-agences garantit une anticipation efficace des menaces asymétriques et une capacité de riposte rapide contre les cellules terroristes dormantes et actives, consolidant ainsi le rôle du Maroc en tant que pilier de la sécurité régionale et internationale.
A cet égard, depuis 2002, cette dynamique a abouti au démantèlement de plus de 200 cellules terroristes, certaines étroitement liées aux réseaux jihadistes opérant dans la zone sahélo-saharienne, en Syrie et en Irak. Grâce à une stratégie combinant l’exploitation sophistiquée du renseignement, le contre-espionnage technologique et des techniques d’analyse approfondies des réseaux terroristes et criminels, le Maroc se positionne comme un rempart stratégique contre les menaces transnationales et les mutations du terrorisme globalisé. Dans ce sens, le complot terroriste déjoué par le Maroc illustre avec force la détermination du Royaume à contrer des réseaux d’extrémistes aux ramifications transfrontalières. Les services de renseignement, en étroite coopération avec leurs homologues internationaux, ont mis au jour un réseau clandestin dirigé par un haut responsable de Daech, dont l’influence s’étendait jusqu’au cœur du territoire marocain. L’opération du 19 février 2025 est emblématique de cette riposte.

Grâce à des renseignements d'une précision exceptionnelle fournis par la DGST, le BCIJ a mené une opération stratégique qui a neutralisé une cellule terroriste active dans neuf villes marocaines. Douze suspects ont été appréhendés et un important stock d'explosifs, d'armes sophistiquées et de documents sensibles a été saisi dans un centre logistique clandestin à Errachidia, une zone frontalière clé avec l'Algérie et proche du Sahel. Parmi les découvertes majeures figure un arsenal dissimulé, illustrant l'ampleur du complot et l'envergure transnationale des réseaux djihadistes. Des enquêtes approfondies ont révélé que ce réseau est piloté par le chef des Opérations Extérieures de Daesh dans le Sahel, instigateur du complot et orchestrateur de l'opération, épaulé par une équipe de coordinateurs, d'exécuteurs et de facilitateurs logistiques. Par ailleurs, des éléments concordants confirment l'existence d'un sanctuaire logistique stratégique, jouant un rôle crucial dans l'acheminement des armements du Sahel vers le Maroc, via des corridors reliant Gao et Kidal au nord du Mali, en passant par Arlit au Niger, jusqu'à Tamanrasset dans le sud de l'Algérie. L'activation de ces voies discrètes illustre la sophistication des circuits d'approvisionnement jihadistes et souligne l'urgence de renforcer la surveillance des zones frontalières et des axes critiques du trafic d'armes.

Personne ne peut nier, l'instabilité chronique du Sahel repose sur plusieurs facteurs structurels, parmi lesquels la fragilité des États, la porosité des frontières, des bouleversements géopolitiques et l'ingérence d'acteurs non étatique étrangers. Ces éléments créent un terreau fertile pour l'expansion des groupes terroristes et des mouvances séparatistes, qui exploitent ces failles pour asseoir leur influence. L'Algérie, par son soutien au mouvement séparatiste du Polisario, joue un rôle indirect dans cette dynamique conflictuelle, en contribuant à la déstabilisation de la région.
Un exemple emblématique de cette interaction entre séparatisme et terrorisme s'est manifesté en 2016, avec le blocage du passage de Guerguerate, passage frontalier entre le Maroc et la Mauritanie, par les milices armées du Polisario. Cet acte criminel a perturbé les flux commerciaux entre le deux pays, entravant ainsi la coopération régionale et créant des zones grises exploitables par les groupes jihadistes.

De plus, les camps de Tindouf, situés dans le sud-ouest algérien, constituent une autre illustration de cette porosité. Faiblement contrôlés par Alger, ces camps permettent des infiltrations d'armes, des contrebandes et de combattants vers les théâtres d'opérations sahéliens, alimentant ainsi une spirale de violence et d'instabilité.
De surcroit, le lien entre le séparatisme et le terrorisme au Sahel est illustré par la genèse et l'expansion de l’EIGS. Fondé par Abou Adnan Walid Sahraoui, un ancien membre du Polisario, ce groupe terroriste s'est appuyé sur des réseaux existants au sein du mouvement séparatiste pour asseoir sa présence. La vulnérabilité des frontières, en particulier entre l’Algérie et la Mauritanie, associée à une tolérance passive des autorités algériennes vis-à-vis des activités du Polisario, facilite l’essor de ces réseaux clandestins et leur capacité à opérer en toute discrétion. Par ailleurs, la chute de Kadhafi en Libye, conjuguée à la dispersion massive de millions d'armes légers, a considérablement intensifié le trafic d'armes jusqu'à ce jour.
D’ailleurs, un rapport des Nations Unies publié en 2022 met en lumière ces interactions en soulignant des cas avérés de trafic d’armes transitant par les camps de Tindouf. Ces armes alimentent directement les groupes terroristes actifs au Mali, Burkina Faso et au Niger, exacerbant la violence et fragilisant davantage les structures étatiques sahéliennes.
Cette situation conforte l'hypothèse selon laquelle certaines factions du Polisario, en dépit de leur propagande, entretiennent des relations opportunistes avec des groupes jihadistes pour maximiser leur influence et assurer leur survie dans un contexte régional de plus en plus fragmentés. Ainsi, la connivence entre séparatisme et terrorisme au Sahel constitue un facteur aggravant de l'instabilité régionale et sous-régionale. L'absence de contrôle effectif des États, la prolifération des armes et la complaisance de certains acteurs étatiques vis-à-vis des mouvements séparatistes créent un environnement favorable à l'expansion des groupes jihadistes.

Le Maroc un rempart pour l’Europe et un acteur clé de la coopération internationale
Nul doute, les groupes terroristes visent également le Maroc dans une stratégie plus large de déstabilisation visant à ouvrir une brèche vers l’Europe. Dernier rempart avant le Nord-Ouest du continent, le Royaume joue un rôle crucial dans la neutralisation des flux jihadistes transfrontaliers. Sa collaboration avec les services espagnols, américains et français a permis de démanteler plusieurs cellules terroristes. La dernière opération conjointe entre les services marocains et espagnols de novembre 2024 à Tétouan et Madrid est une illustration d’une coopération sécuritaire exceptionnelle.
Sur le plan stratégique, le Maroc est un partenaire clé des États-Unis dans le cadre du Programme de lutte contre le terrorisme transsaharien (TSCTP). L'échange stratégique d’informations entre la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et la CIA a joué un rôle crucial dans la neutralisation de menaces qui dépassaient largement les frontières du Maroc.

Un exemple emblématique de cette coopération efficace est l’opération visant la cellule de Daech de Cole Bridges Gonzalez, où les capacités conjointes de renseignement ont permis de démanteler un réseau terroriste opérant au-delà des frontières nationales, bien avant des attaques potentielles. Ce partenariat, fondé sur un partage de données sensibles, a démontré l’importance de l’intelligence transnationale dans la lutte contre les menaces globales liées au terrorisme.

Conscient que la lutte contre l’extrémisme ne peut être uniquement sécuritaire, le Maroc a adopté une stratégie intégrant prévention et développement socio-économique. La Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains joue un rôle clé dans la promotion d’un islam tolérant et la formation des imams, tandis que des programmes économiques renforcent la résilience des populations face aux discours extrémistes. Toutefois, la persistance des foyers terroristes au Sahel et l’implication d’acteurs extérieurs, comme le groupe Wagner, compliquent la stabilisation de la région. L’échec des interventions militaires classiques a renforcé l’ancrage des groupes jihadistes, exigeant une vigilance accrue et une réadaptation des stratégies de lutte contre le terrorisme.
A n’en point douter, l'approche sécuritaire du Maroc ne se limite pas à la protection de ses frontières, mais vise également à contenir la menace terroriste avant qu’elle n’atteigne son territoire. Grâce à une coopération soutenue avec les pays du Sahel et les agences occidentales, les services marocains ont pu désorganiser plusieurs chaînes d’approvisionnement en armes et en financement des groupes jihadistes opérant entre le Mali, le Niger et la Libye.
En parallèle, les flux de combattants étrangers transitant par le Maghreb vers le Sahel ont été fortement réduits grâce à une intensification des contrôles frontaliers, de la surveillance aérienne et du partage de renseignements avec les pays voisins. Ainsi, l’influence marocaine s’exerce également au niveau politique et diplomatique. En plaidant pour une approche holistique combinant sécurité et développement, le Maroc a contribué à changer la perception des solutions à long terme pour contrer l’instabilité sahélienne. La mise en œuvre de projets de coopération économique et d’aide humanitaire dans des régions sensibles a permis de réduire l’attrait des groupes jihadistes auprès des populations marginalisées.
De ce fait, en s'attaquant à la structuration financière des organisations terroristes, le Maroc a joué un rôle crucial dans le démantèlement des circuits clandestins de financement jihadiste transitant par les provinces du sud du Maroc, la Mauritanie et le Mali. Grâce à une traçabilité accrue des flux financiers et à une coopération renforcée avec les institutions bancaires régionales, plusieurs sources de financement du terrorisme ont été identifiées et bloquées, limitant ainsi la capacité opérationnelle des groupes extrémistes.
Vers une redéfinition des stratégies sécuritaires
L’enjeu sahélien, qui constitue l’un des foyers terroristes les plus persistants, met en lumière les limites des approches purement sécuritaires. L’échec des interventions militaires classiques, notamment celles menées dans le cadre de l’opération Barkhane, a favorisé l’ancrage de groupes terroristes qui exploitent la fragmentation des États et la faiblesse des institutions locales. L’implantation de mercenaires étrangers, tels que le groupe Wagner, accentue cette instabilité, rendant indispensable une refonte des stratégies sécuritaires.
Face à cette réalité, le Maroc s’impose comme un acteur clé en développant une approche hybride associant renseignement de haute précision, diplomatie proactive et initiatives de développement économique. La modernisation des capacités de surveillance, couplée à la promotion d’un islam modéré par des institutions comme la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains, illustre cette stratégie multidimensionnelle visant à assécher le terreau de la radicalisation.

C’est pourquoi, les menaces asymétriques de demain exigeront une vigilance accrue et une innovation permanente dans les stratégies sécuritaires. L’intégration du Maroc dans des alliances de renseignement de haut niveau avec les USA et le Royaume-Uni à l’image des accords de Five Eyes constituerait une avancée stratégique majeure en renforçant ses capacités en cybersécurité et en renseignement électromagnétique. Car, la lutte contre le terrorisme ne se gagnera pas uniquement par la force, mais par une combinaison de technologies disruptives, d’anticipation stratégique et de coopération multilatérale. Dans ce cadre, le Maroc, en tant que pivot sécuritaire en Afrique et en Méditerranée et l’Atlantique, a un rôle central à jouer dans la redéfinition des paradigmes de la sécurité mondiale.
A l’aune, le Maroc se trouve au cœur d’un paysage sécuritaire complexe, à cheval entre ses responsabilités de pilier régional et les ambitions expansionnistes de groupes terroristes comme État Islamique au Grand Sahara et ses affiliés, ainsi que les dynamiques séparatistes incarnées par certaines factions du Polisario. Son positionnement stratégique et son engagement en faveur d’une intelligence opérationnelle de pointe le placent en première ligne dans la lutte contre le terrorisme transnational. Grâce à une doctrine de défense robuste, une modernisation constante de ses forces et une coopération internationale étroite, le Royaume s’impose comme un véritable pourvoyeur de sécurité mondiale. Paradoxalement, c’est précisément cette efficacité en matière de renseignement et de sécurisation des frontières qui en fait une cible privilégiée pour ceux qui cherchent à déstabiliser l’équilibre régional.

Enfin, dans un contexte géopolitique déjà fragile, la menace que représente Daech est en train de trouver un terrain de plus en plus fertile au cœur du Sahel, exacerbée par la faiblesse des structures étatiques et l’inaction internationale. Si des mesures urgentes et concertées ne sont pas prises, la situation risque de devenir irréversible. En délocalisant ses activités de manière stratégique dans cette région, le groupe terroriste ne se contente pas de semer la terreur localement, il prépare également le terrain pour un péril global.
Maintenant, plus que jamais, il est crucial pour la communauté internationale de comprendre la portée de ce danger et d’agir de manière unifiée. L’extension de Daech au-delà des frontières sahéliennes, notamment vers l’Europe et l’Atlantique, est plus qu’une simple possibilité ; c’est une réalité qui se dessine chaque jour un peu plus clairement. Si la communauté internationale ne se mobilise pas de manière décisive et immédiate, c'est l’ensemble du monde qui risque de souffrir les conséquences de ce fléau, longtemps considéré comme distant mais désormais à nos portes. Le Sahel ne pourra plus être un simple laboratoire de terreur, il sera le point de départ d’une déstabilisation mondiale d’une ampleur inédite. Il est grand temps d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Face à ce scénario catastrophique, la communauté internationale se doit d’agir sans délai pour contrer l’expansion de Daech dans le Sahel et au-delà. Imaginez un avenir où, sans intervention coordonnée, les réseaux jihadistes s’étendraient de ce foyer déjà instable à l’ensemble du continent africain, menaçant même l’Europe et d’autres régions stratégiques.
Ce danger n’est pas une abstraction : il représente une menace réelle pour la stabilité mondiale, une dérive qui pourrait transformer des zones de conflit localisé et des zones grises en foyers de radicalisation transnationale. Il est grand temps de le dire sans détour, même si les cyniques et les sceptiques persistent à minimiser la gravité de la situation : le temps presse, et l'inaction de la communauté internationale risque de faire basculer le monde dans une crise sécuritaire d'une ampleur jamais vue.
Le moment d'agir est maintenant, sous peine de voir des menaces se propager bien au-delà de ce que nous imaginons.