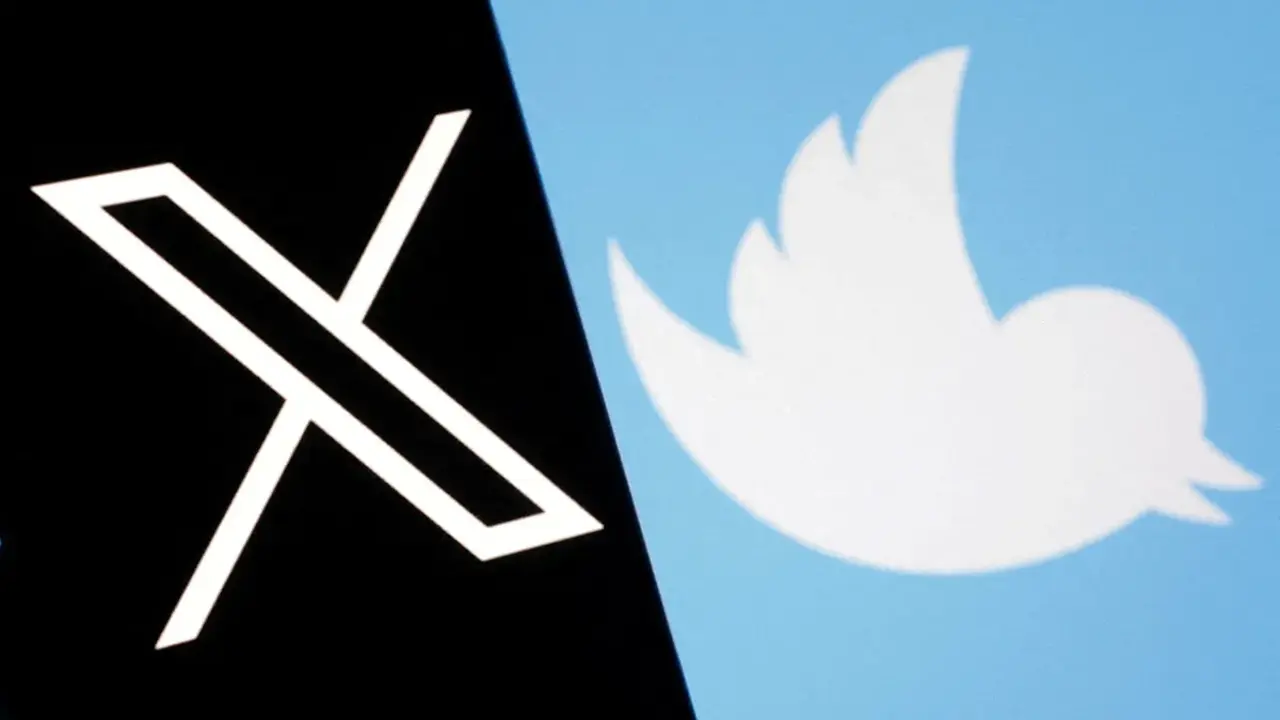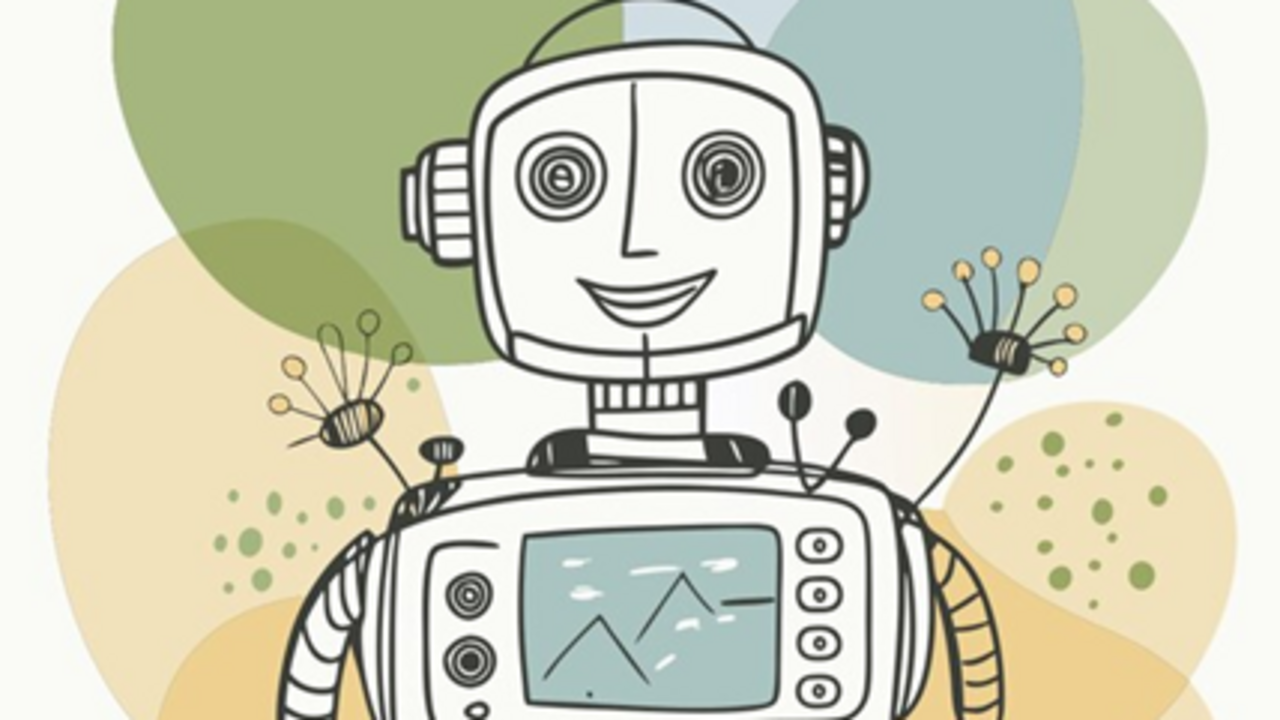Trump et Poutine conviennent de la fin de la Station spatiale internationale, l'Europe en spectatrice

Les présidents Trump et Poutine ont donné leur feu vert à la proposition qui leur a été faite par les dirigeants de leurs agences spatiales respectives : désorbiter et laisser tomber sur Terre en 2030 la Station spatiale internationale et faire sombrer ses débris dans les profondeurs de l'océan Pacifique.
Cette décision met fin, dans environ cinq ans, à la plus grande initiative de coopération spatiale de tous les temps. Elle marque la fin de trois décennies de collaboration efficace et ininterrompue entre l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis, la NASA, et son homologue russe, Roscosmos.
Le projet a le grand mérite d'avoir surmonté les affrontements et les tensions graves entre Washington et Moscou, et même les sanctions et les représailles imposées par les deux parties à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Cela a été rendu possible grâce à la priorité accordée aux recherches à bord de l'ISS et à la survie des équipages mixtes composés de cosmonautes russes et d'astronautes américains et de pays tiers, dont beaucoup sont européens.

L'accord conclu, pour l'instant verbal, entre les responsables de la NASA et de Roscosmos, après huit ans sans rencontre face à face (depuis octobre 2018), confirme que les deux agences continueront à diriger, gérer et utiliser conjointement et en toute sécurité jusqu'en 2030 la Station spatiale internationale, ISS. La fin de sa vie opérationnelle était prévue pour 2024 et, bien que ses infrastructures aient été améliorées, certains modules du complexe orbital montrent des signes de fatigue.
L'accord conclu entre le nouvel administrateur par intérim de la NASA, le politicien républicain et présentateur de télévision Sean Duffy, 53 ans, qui cumule cette nouvelle fonction avec celle de secrétaire aux Transports, poste qu'il occupe depuis janvier 2025, est le principal résultat de la visite aux États-Unis, fin juillet, d'une petite délégation de hauts responsables de Roscosmos, conduite par son directeur général depuis six mois, Dimitri Bakanov, 39 ans.

Désaccords sur Terre, coopération en orbite
Le chef de l'Agence spatiale russe a été invité à une « visite de travail » - comme l'a qualifiée la NASA - pour assister depuis le Centre spatial Kennedy en Floride au lancement vers l'ISS de la capsule habitée Dragon Crew-11 à bord d'une fusée Falcon 9 de la société SpaceX d'Elon Musk. Quatre passagers, qui se trouvent déjà à bord de l'ISS, ont pris part à la mission Crew-11 qui a décollé le 1er août, dont le cosmonaute Igor Platonov, lieutenant-colonel de l'armée de l'air russe.
Avec le feu vert de la Maison Blanche et du Kremlin, Duffy et Bakanov ont convenu que les recherches, les essais et les expériences des équipages à bord de l'ISS se poursuivront « au moins jusqu'en 2028 », et que les Russes et les Américains « travailleront ensemble pendant environ deux ans pour définir le profil de sa désorbitation en 2030 », a déclaré le chef des activités spatiales russes.
Pour sa part, Sean Duffy a déclaré que les États-Unis et la Russie « ont des désaccords et des conflits ici, mais trouvent des points de collaboration dans le cadre de l'ISS et ne gaspillent pas ces relations ».

Bakanov est resté trois jours sur le sol américain depuis le 30 juillet, en compagnie de trois autres hauts dirigeants de Roscosmos. L'un de ses accompagnateurs était le directeur des programmes habités et, depuis mai dernier, représentant spécial du président Poutine pour la coopération spatiale internationale, le cosmonaute vétéran Sergei Krikalev, 66 ans, qui totalise six vols spatiaux, 803 jours en orbite et plus de 41 heures de travail dans l'espace.
Au cours de son court séjour aux États-Unis et avant de s'envoler pour Cap Canaveral pour assister au décollage de la mission Crew-11, la petite délégation russe dirigée par Bakanov a visité le Centre spatial Johnson, où s'entraînent les astronautes et cosmonautes – dont trois Russes actuellement – qui doivent se rendre à l'ISS. Ils ont également visité le Centre de contrôle des missions habitées de la NASA, tous deux situés à Houston, au Texas.

Ce qui est prévu après l'ISS
Bakanov et son entourage ont profité de l'occasion pour rencontrer l'équipe de techniciens spatiaux que Roscosmos a déployée au Centre de contrôle de Houston, qui assure la liaison officielle avec son homologue russe situé près de Moscou (TsOuP).
Les centres de contrôle de vol de Houston et de Moscou collaborent et partagent la supervision de la sécurité, de l'habitabilité et des conditions de travail des équipages à bord de l'ISS. Situé à une altitude moyenne d'environ 400 kilomètres, un centre est chargé des infrastructures américaines et l'autre des infrastructures russes.
Au-delà de 2030, la NASA s'est engagée à soutenir et à mener à bien une ou plusieurs initiatives de stations spatiales commerciales en orbite basse, pour lesquelles elle s'est associée à des entreprises telles que Axiom Space, Blue Origin et Voyager Technologies. L'agence fédérale souhaite transférer vers les nouveaux complexes orbitaux privés certaines des capacités de recherche qui seront perdues avec la disparition de l'ISS, en particulier les essais pour les entreprises pharmaceutiques.

Tout porte à croire que l'agence américaine sera également un bon client des stations spatiales privées. La NASA a besoin d'un endroit où placer ses astronautes en orbite terrestre basse, car ses efforts visent à retourner sur la Lune, puis à se diriger vers Mars. Du côté russe, le président Poutine souhaite disposer de sa propre station spatiale ROS, dont la construction devrait commencer fin 2027 et s'achever en 2033.
L'ISS est le résultat d'un accord intergouvernemental mené par les États-Unis. Signé le 29 janvier 1998 sous la présidence de Bill Clinton, la participation de la NASA au projet en termes d'infrastructures, de ressources et de financement pour son exploitation s'élève à environ 76,6 % du coût total, ce qui confère à l'agence spatiale désormais dirigée par Trump une suprématie absolue en matière de prise de décision concernant le complexe orbital.

Le deuxième contributeur en importance est la Russie, qui apporte environ 12 %, principalement en infrastructures et en vecteurs de transport spatial aller-retour des équipages. Les trois autres partenaires de l'ISS ont une participation minoritaire dans le projet. L'un d'eux est l'Agence spatiale européenne (ESA), dont dix nations, dont l'Espagne, se partagent environ 8,3 % de la contribution. Les deux autres sont l'agence japonaise (JAXA), qui contribue à hauteur de 2,8 % des coûts, et l'agence canadienne (CSA), qui apporte 0,3 %.